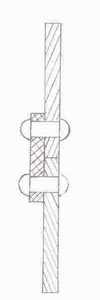|
"LE
TENEUR DE TAS"
introduit le rivet dans le trou préparé
et le maintient au moyen du tas, simple tige de fer ou appareil pneumatique
plus élaboré. C'est souvent un jeune garçon de 16 à 20 ans "qui doit
se faire une constitution robuste" qui tient cette place.
"LE
RIVEUR"
frappe directement au marteau ou par l'intermédiaire d'une bouterolle
sur l'extrémité libre du rivet. Le riveur est un ouvrier responsable du
travail. Il a acquis sa compétence et son statut social, après de
longues années où il a d'abord été chauffeur de rivet puis "teneur
de tas".
Tentative de modernisation
du rivetage
La mécanisation a essayé sans succés de modifier
les techniques de rivetage au XIXe siècle. Elle n'a réussi
qu'à faire exécuter par la machine l'opération d'écrasement des rivets
ne pouvant lui demander et de percer les trous et de chauffer les rivets
et de pouvoir les introduire, les trois réalisation durent toujours se faire
manuellement. Dans la constrution navale au cours du XIXe siècle le nombre
de rivets à poser augmentait prodigieusement et le coût de l'opération
de rivetage devenait trop onéreux. Outre qu'il fallait suppléer la
force de l'homme il fallait alors augmenter les cadres, réduire le
nombre de rivets en assemblant des tôles de plus en plus grandes diminuant
aussi le nombre d'assemblage à réaliser, trouver une méthode
d'assemblage de substitution. Pendant tout le XIX siècle ce fut une quête
pour mécaniser puis automatiser le rivetage. Des machines à river
furent mises au point : celles de Fairbairn en 1822 puis en 1843 (exposition
industrielle de Paris en 1844) de Tweddell (1865). Elle furent d'abord mécaniques
puis à vapeur, puis hydrauliques avant de devenir "mixtes" à la fin du siècle
en combinant des techniques distinctes. Ces machines devenant de plus en
plus lourdes et chères pour assembler des tôles trop larges, n'ont
servi que dans des grosses entreprises (Creusot) pour des fabrications très
spéciales. Lorsque leur taille se
fut réduite (meilleure qualité des aciers, alliage d'aluminium) et qu'elles
devinrent portatives, on put les utiliser pour un type d'assemblage determiné
: rivetage de dômes de locomotive, poutrelle, quille de navires...
Le marteau pneumatique
L'écrasement des rivets par pression, que les
machines permettaient, était cependant plus satisfaisant que celui
obtenu par percussion du rivetage manuel. Cet avantage pesa peu face à l'apparition
d'appareils modestes (présentés par les Etats-Unis à l'exposition universelle
de paris en 1900) : les marteaux pneumatiques, issus des perforateurs utilisés
pour creuser les tunnels et les mines. Ces marteaux pneumatiques permettaient
toutes les fonction suivant l'outil dont on les munissait : un burin, une
bouterolle. Leur poids (et leur consommation d'air se réduisant,
ils s'imposèrent sur tous les chantiers. Une bouterolle leur fut
adaptée qui écrasait les rivets dont ils bombaient la tête. Le rivetage
devenait beaucoup plus rapide et demandait moins d'efforts physiques, et
assurait des gains énormes de productivité. Cependant l'utilisation
de ces marteaux ne fit pas décroître le taux de la maladie professionnelle
des chaudronniers qui affectait le coude et la perception auditive.
Méthode d'assemblage
par la soudage
La soudure a été pressentie dès le XIX
siècle comme rivale du rivetage à chaud. Si on l'utilisait pour des barres
métalliques sur le feu de forge par chauffage local, on était incapable
de souder des tôles à cause de l'homogénéité imparfaite du métal
(fer, acier) et les déformations qui apparaissaient. Le rivetage à chaud
avait ses défauts : des avaries au niveau des rivures ont provoqué des explosions
d'appareils à vapeur ; les milliers de perçage à faire sur une pièce produisant
une suppression de métal participant à des affaiblissements de structure
; l'apport de millions de rivets alourdissait les ensembles (11millions
de rivets sur le NORMANDIE) ; mobilisation de nombreuses équipes de
rivetage, "coûteuses" en salaires et en temps.
|